Une avancée pionnière contre l’inflammation liée à l’âge
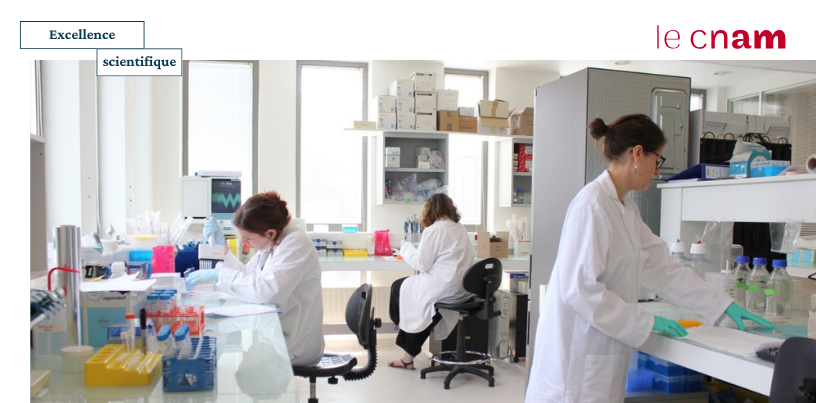
6 novembre 2025
Au Cnam, la recherche avance avec patience, exigence et un sens aigu de l’intérêt général. C’est dans cet esprit que s’inscrit le travail du professeur Jean-François Zagury, titulaire de la chaire de bioinformatique depuis 2004 et directeur du laboratoire GBCM. Son équipe vient de franchir une étape déterminante : la publication, dans la revue Nature Communications, des résultats d’un essai clinique de phase 1 portant sur une immunothérapie innovante contre l’inflammation chronique de bas grade, un phénomène central du vieillissement biologique.
Cette publication dans une revue prestigieuse marque un moment important pour le Cnam et pour Peptinov (la start-up issue du laboratoire qui porte ce projet), ainsi que pour toute la communauté scientifique engagée dans la lutte contre les maladies liées à l’âge.
Agir sur l’IL-6 : une idée simple, une stratégie ambitieuse
Au cœur du projet se trouve une intuition aussi élégante que robuste : agir, par une approche d’immunothérapie active, pour moduler l’interleukine-6 (IL-6), une molécule pro-inflammatoire produite par notre organisme en réaction de défense contre les agressions, mais dont l’activité devient plus difficile à réguler avec l’âge.
Avec les années, cette dérégulation de l’IL-6 entraîne une inflammation diffuse mais persistante, dite « de bas grade ». Elle ne provoque pas de fièvre, n’alerte pas l’organisme, mais favorise l’apparition de nombreuses pathologies du vieillissement car elle contribue à la détérioration des tissus : arthrose, douleurs chroniques, maladies cardio-métaboliques, faiblesse musculaire, fragilités multiples.
Pour répondre à cet enjeu, Jean-François Zagury et son équipe ont conçu une immunothérapie active, comparable dans son principe à un vaccin. Le candidat médicament, PPV-06, incite l’organisme à produire lui-même des anticorps capables de moduler l’excès d’IL-6. L’idée n’est pas de bloquer complètement cette molécule essentielle, mais d’en moduler l’activité grâce aux anticorps induits anti-IL-6 qui maintiennent un équilibre compatible avec un vieillissement en meilleure santé.
Cette approche, élaborée au Cnam puis développée cliniquement par Peptinov, ouvre une nouvelle voie : celle d’un traitement pouvant agir durablement sur les mécanismes profonds de l’inflammation de bas grade.
Une phase 1 concluante : une immunothérapie sûre et des signaux cliniques encourageants
L’essai clinique de phase 1, mené sur 24 participants atteints d’arthrose inflammatoire du genou, a eu lieu à l’hôpital Cochin au sein du service dirigé par le Pr Rannou, expert de l’arthrose. Il visait avant tout à vérifier la sécurité du traitement. Les résultats sont nets :
PPV-06 est bien toléré, n’a entraîné aucun effet indésirable grave, et les réactions observées sont celles d’un vaccin classique.
Mais l’étude révèle également plusieurs éléments prometteurs. Tous les participants traités ont développé des anticorps neutralisant l’IL-6, et une tendance à l’amélioration clinique (douleur, symptômes, qualité de vie) est observée dans les groupes traités. Surtout, les patients dont l’organisme produit le plus d’anticorps anti-IL-6 sont ceux qui évoluent le plus favorablement sur le plan clinique. Pour un essai de phase 1, dont ce n’était pas l’objectif, ce signal mérite d’être souligné.
La reconnaissance de ces résultats par Nature Communications confère à cette innovation un poids scientifique certain à ce stade du développement.
Peptinov et le Cnam : une alliance structurante entre recherche et innovation
Si PPV-06 existe aujourd’hui, c’est aussi grâce à une articulation exemplaire entre la recherche publique et l’innovation privée.
Le laboratoire GBCM du Cnam a permis le lancement de plusieurs start-up issues directement de ses travaux (on les appelle des spin-offs), un modèle encore peu commun dans le paysage académique français. Ces spin-offs sont en charge de trouver les fonds nécessaires à la valorisation industrielle des candidats médicaments développés, ce que l’Etat ne peut pas faire car les sommes en jeu pour de tels projets sont considérables (notamment dans le domaine pharmaceutique).
Peptinov, fondée par Jean-François Zagury, a pris en charge le développement clinique et réglementaire du projet. Il est à souligner que plusieurs anciens doctorants du laboratoire GBCM font partie de l’équipe de R&D de Peptinov, ce qui montre leur attachement au projet scientifique développé. De son côté, le Cnam apporte la profondeur scientifique, l’expertise en génomique et en bioinformatique, et un environnement favorable pour accompagner la création de projets d’innovation thérapeutique.
Cette dynamique illustre le rôle essentiel de la recherche publique : donner l’élan, la crédibilité, l’espace intellectuel nécessaires pour que la science puisse devenir un outil concret au service de la société. C’est d’ailleurs la première mission scientifique du Cnam telle que l’avait conçue l’Abbé Grégoire.
20 millions d’euros pour la phase 2 : un enjeu scientifique et stratégique
La prochaine étape sera déterminante : la réalisation d’un essai clinique de phase 2, destiné à évaluer l’efficacité du traitement à plus grande échelle. Cette étape a un coût important (environ 20 millions d’euros), car elle implique plusieurs centres de recherche clinique en France et à l’étranger avec l’inclusion de plus de 200 patients souffrant d’arthrose du genou.
Dans un contexte où les thérapies du vieillissement suscitent un intérêt mondial, cette publication dans Nature Communications apporte une crédibilité importante pour attirer des partenaires, des collaborations, et des financements.
Une aventure scientifique et humaine
Derrière les résultats et les données cliniques, il y a un parcours. Celui d’un chercheur, de son équipe, et de plusieurs générations de doctorants qui ont contribué à bâtir une idée, à la tester, à la confronter au réel, puis à la porter jusqu’à l’essai chez l’humain.
Cette réussite rappelle que l’innovation médicale est un chemin de longue haleine, fait d’intuition, de rigueur, d’obstacles et de persévérance. On peut ainsi rappeler que la conception du produit PPV-06 date de 2012, et qu’il aura ainsi fallu attendre 13 ans pour en avoir une première validation clinique chez l’homme (un temps tout à fait usuel pour une innovation pharmaceutique).
Cette réussite rappelle aussi que la recherche publique contribue à des avancées de premier plan susceptibles, demain, d’améliorer la vie de millions de personnes. Avec cette première validation clinique, le Cnam confirme sa place dans la recherche biomédicale internationale et ouvre une perspective nouvelle dans la lutte contre les maladies du vieillissement.
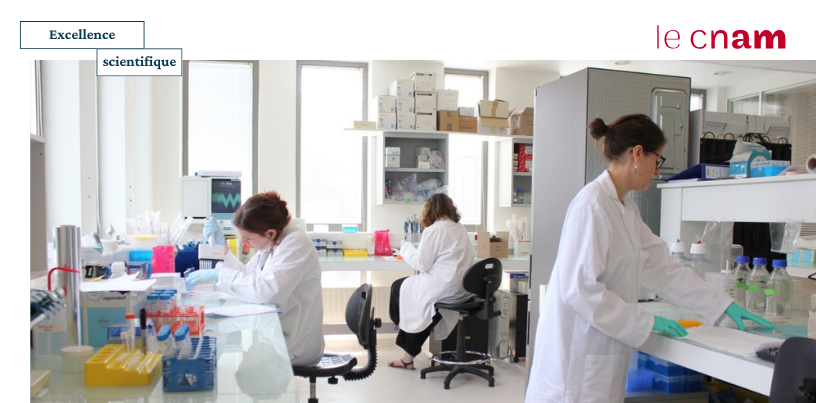
6 novembre 2025
Photo fournie par Jean-François Zagury
Consulter la publication: (téléchargement pdf)















